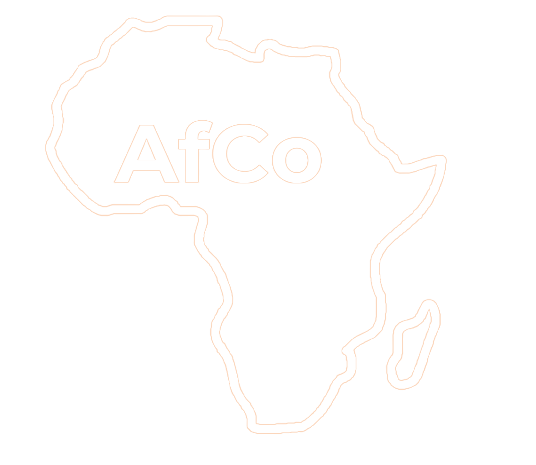L’or : richesse ou malédiction ?
Coordination du numéro
Marc Raffinot
L’or en Afrique, le partage de la richesse et la montée des violences
La production d’or en Afrique a connu récemment une croissance rapide. Elle soulève des espoirs en termes de nouvelles ressources pour le développement, mais aussi des craintes de retombées négatives, notamment en termes de gouvernance (comme le suggère l’approche de la « malédiction des ressources »). Ce ne sont là que deux facettes d’un vaste débat, car l’or a toujours été porteur de multiples enjeux, économiques, politiques, environnementaux et symboliques. Les quatre plus gros pays producteurs africains sont le Ghana, l’Afrique du Sud, le Soudan et le Mali, mais la production d’or joue également un rôle important dans des pays comme la RDC ou le Burkina Faso.
C’est souvent la production des mines modernes qui retient l’attention, notamment celle des pouvoirs publics pour des raisons principalement fiscales. Mais cette production coexiste avec une production artisanale considérable en termes de production et d’emplois. En Afrique de l’Ouest seulement, on estime que l’orpaillage occupe au moins deux millions de personnes et en fait vivre plus de douze (un million au Burkina Faso, 700 000 au Mali, et 300 000 au Niger)
Sur le plan économique, l’impact de l’extraction d’or sur les populations fait l’objet de controverses. Dans le secteur minier moderne, les acteurs sont souvent des entreprises multinationales des États-Unis (Newmont), du Canada (Barrick Gold, Kinross Gold, Agnigo Eagle, d’Afrique du Sud (AngloGold Ashanti, GoldFields, Harmony), de Russie (Polyus, Polymetal) ou encore d’Australie (Newcrest). Les avantages que les codes miniers ont procuré aux entreprises d’extraction de l’or et d’autres produits miniers sont souvent importants et ont été étudiés (Cambell, 2010 et 2019). D’autres auteurs ont insisté sur l’opacité du commerce mondial de l’or, en l’opposant à celui des diamants qui est structuré par le processus de Kimberley.
À côté des mines modernes, il existe une vaste activité artisanale d’orpaillage, sur laquelle l’information est limitée (notamment en ce qui concerne les circuits commerciaux). Des études ont comparé l’impact de l’extraction sur différents aspects du niveau de vie de la population. Beaucoup soulignent l’impact négatif de l’orpaillage, notamment en termes de santé et d’environnement : accidents, pollution au mercure, diffusion du HIV SIDA, (Leclerc Olive 2022, Survie 2007), de violence, de déscolarisation (Soïba Traore et Lauwerier, 2020), Toutefois, Bazillier et Girard (2020) ont utilisé des données géolocalisées pour montrer que l’impact de l’orpaillage sur le bien-être de la population est supérieur à celui des mines modernes. Cette étude, comme celle de Pokorny et al. (2019) réalisée sur la base d’enquêtes approfondies, milite pour la mise en place de politiques publiques qui accompagnent l’enrichissement dû à l’orpaillage, plutôt que de politiques publiques cherchant à réprimer l’orpaillage, voire à l’éliminer en faveur des méthodes industrielles.
Parmi les politique publiques les plus sensibles pour l’orpaillage les politiques liées aux droits fonciers et à l’accès à l’eau occupent une place centrale, car producteurs industriels d’or, orpailleurs et populations autochtones s’affrontent souvent (Goujon 2022), notamment lorsque l’orpaillage débouche sur des urbanisations non encadrées (Cros et Mégret, 2018 ; Gagnol et al. ,2022 ; Ayeh, 2022).
Sur le plan des conflits, l’or est une ressource pour les États du fait des royalties et des impôts sur l’activité économique directe et induite, ainsi que pour diverses organisations gouvernementales et/ou rebelles. Les activités d’exploitation industrielle et artisanale ont été mises en relation avec les attaques terroristes par une approche cartographique dans le cas du Burkina Faso (Théry et Dory, 2021). L’activité artisanale débouche sur des modalités de commercialisation complexes et peu transparentes (Ouedraogo, 2022), convergeant souvent vers Dubaï pour alimenter la Suisse (Bolay et Schulz, 2022) et la Chine.
L’or donne des moyens aux gouvernements, mais attise en même temps les appétits de ceux qui veulent s’emparer du pouvoir. Ceci complexifie encore la question de la formalisation de l’orpaillage, puisque les initiatives dans ce domaine risquent de jeter les orpailleurs dans les bras des groupes rebelles (Crisis Group, 2019 ; Ouedraogo, 2022). C’est pourquoi l’étude des pratiques à ce niveau, comme celles des centrales d’achat (Traoré 2022 dans le cas de la région de Sikasso) retient l’attention.
L’or est aussi une ressource symbolique puisque diverses parties prenantes sont régulièrement accusées de « pillage des mines d’or » : la « soif sacrée de l’or » alimente bien des fantasmes, en ce que l’or est assimilé à la richesse par excellence (sans que l’on s’attarde beaucoup sur les coûts de production). L’or se trouve donc logiquement accusé d’être au cœur des aventures coloniales et néo-coloniales (que ce soient celles de la France ou de la Russie, qui a exploité l’or ouest africain durant la période « socialiste » de la Guinée et du Mali).
Il ne faut pas oublier enfin la dimension historique, puisque l’or était au centre du commerce transsaharien (or contre sel). L’exploitation de l’or, liée à l’esclavage, s’est aussi développée notamment en « Gold Coast », bien avant la colonisation britannique (Akurang-Parry Kwabena, 2014). Le commerce de l’or dans cette région est concomitant des débuts d’une traite des esclaves à destination du Portugal dès la fin du XV siècle, comme en témoigne la construction à Elmina du premier édifice européen sous les tropiques, le fort Sao Jorge da « Mina » (« La mine [d’or]») en 1482. Puis la découverte des richesses minières de l’Afrique du Sud déclencha une ruée vers l’or qui marquera durablement le pays.
Enfin, des ethnologues ont mis en lumière de nombreuses pratiques sociales liées à l’or, et notamment celles destinées à conjurer son pouvoir maléfique, notamment chez les Lobis (Mégret 2008, Cros et Mégret, 2018).
Ce dossier d’Afrique contemporaine vise à fournir des études sur ces différents aspects, en privilégiant autant que possible le lien entre l’or et les diverses formes de conflictualité.
Les contributions attendues pourront aborder la question « l’Or, richesse ou malédiction ? » , autour de 4 thématiques
L’impact des extractions d’or sur les populations
L’or, source de conflictualité
Or et ingérence extérieure
Les politiques publiques : comme éviter la « malédiction »
Toutes les disciplines – socio-économie, économie politique, sciences politiques, socio-anthropologie du développement – pourront être mobilisées pour traiter ces thématiques. Des contributions portant sur des cas précis d’étude, dans différents contextes africains sont attendues.
Références
Ayeh Diana (2022), Le droit minier face à l’éthique de l’or, Contestations autour d’une concession minière au Burkina Faso, Revue internationale d’études du développement,
Bazillier R. et Girard V. (2020), “The gold digger and the machine. Evidence on the distributive effect of the artisanal and industrial gold rushes in Burkina Faso”, Journal of Development Economics, 143, 102411.
Bolay Matthieu et Schulz Yvan, (2002) « Les conditions disputées d’un approvisionnement « responsable » en or », Revue internationale des études du développement, p. 63-88.
Cambell Bonnie (2019), Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality” Introduction, numéro spécial {Extractive} Industries and Society, Volume 6, Issue 3, July 2019, p 635-641. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479
Cambell Bonnie (2010), Ressources minières en Afrique. Quelle réglementation pour le développement? Presses de l’Université du Québec (PUQ), Québec, CRDI, Ottawa et Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.
Crisis Group (2019), Reprendre en main la ruée vers l’or au Sahel central, Rapport Afrique N°282 | 13 novembre 2019.
Cros, Michèle, et Quentin Mégret. (2018), « L’or, le sang, la pluie et les génies. Chroniques ethnographiques d’un conflit entre orpailleurs et autochtones lobi du Sud-Ouest burkinabè », Afrique contemporaine, vol. 267-268, no. 3-4, 2018, pp. 113-134.
Goujon Emmanuel (2022) « Afrique de l’Ouest : le nouveau paradigme de l’espace et du temps des orpailleurs », Veille, 20 octobre 2022.
Gagnol Laurent, Rhoumour Ahmet, Afane Tchilouta et Abdoulkader Afane (2022), « Enjeux territoriaux et éthiques de la régulation de la ruée vers l’or au nord du Niger », Revue internationale d’études du développement. p.173-196.
Leclerc-Olive Michèle (2022), L’eau de l’or : à l’heure des éthiques de l’environnement, Revue internationale d’études du développement, p.121-146
Mégret, Quentin. (2008). L’or « mort ou vif ». L’orpaillage en pays lobi burkinabé, in Cros M. et Bonhomme J. (sous la direction de), 2008, Déjouer la mort en Afrique, orphelins, fantômes, trophées et fétiches. L’Harmattan.
Ouedraogo Assane, (2022), “Rapports de force autour de l’exploitation artisanale de l’or au Sahel », Ecole de guerre économique, septembre, https://www.ege.fr/infoguerre/rapports-de-force-autour-de-lexploitation-artisanale-de-lor-au-sahel
Pokorny, B.; Von Lübke,; Dayamba, Sidzabda Dj. ; Dickow, H. (2019) “All the gold for nothing? Impacts of mining on rural livelihoods in Northern B urkina Faso”, World development, July 2019, Vol.119, pp.23-39.
Sawadogo Edith, Da Dapola Évariste Constant (2020), « Orpaillage et dynamiques des modes d’accès aux ressources naturelles à Kampti », Revue de Sciences Sociales- RSS-PASRES, p.106-124.
Soïba Traore, I. & Lauwerier, T. (2020). « Les écoliers sur les sites d’orpaillage au Mali : une des niches de la déperdition scolaire ». Mondes en développement, 3(3), 137-151
Survie, L’Or africain : Pillages, trafics & commerce international, 2007
Théry Hervé et Dory Daniel, (2021) « Solhan : cartographier le terrorisme et la dynamique territoriale d’une insurrection », Mappemonde : http://journals.openedition.org/mappemonde/6129 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mappemonde.6129
Traoré N’gna (2022), Arène de l’orpaillage : acteurs et enjeux des centrales d’achat d’or de Kadiolo, au Mali, Revue internationale d’études du développement, p.147-172.
Akurang-Parry Kwabena O. (2014), To Wassa Fiase for Gold: Rethinking Colonial Rule, El Dorado, Antislavery, and Chieftaincy in the Gold Coast (Ghana), 1874–1895. History in Africa, p.11-36.
Calendrier
* Lancement formel de l’appel à contribution : 5 janvier 2023.
* Date limite pour adresser une proposition (rapide exposé du déroulé de l’argumentaire et des données/terrains mobilisé(e)s) : 15 février 2023.
* Réponse de la rédaction aux auteurs au plus tard le 30 avril 2023.
* Réception d’une première version des articles pré-sélectionnés au plus tard le 15 juin 2023 La demande de rédaction V1 ne préjuge pas de l’acceptation définitive de l’article.
* Décision de principe pour retenir ou non l’article pré-sélectionné, et ce après l’avis de deux examinateurs : 31 juillet 2023.
* Si l’article est retenu, sous réserve de modifications éventuelles, finalisation de l’article en question : 1er septembre 2023
* Parution fin 2023-début 2024.
Soumission des articles
* Les propositions d’articles, en français, anglais, ou espagnol, en Times new Roman 12 doivent compter 45 000 signes (espaces et ponctuation compris) en incluant tous les tableaux, cartes, dessins, formules, graphiques, notes et références bibliographiques.
* Les références citées doivent être présentées selon le format APA
*l’examen des documents se fera selon l’approche dite du double aveugle, auprès de deux évaluateurs spécialistes.
* Les articles soumis doivent être accompagnés de deux résumés de 600 signes chacun, en français et en anglais et de 4 à 6 mots-clés.
* Les adresses auxquelles envoyer les documents sont les suivantes :